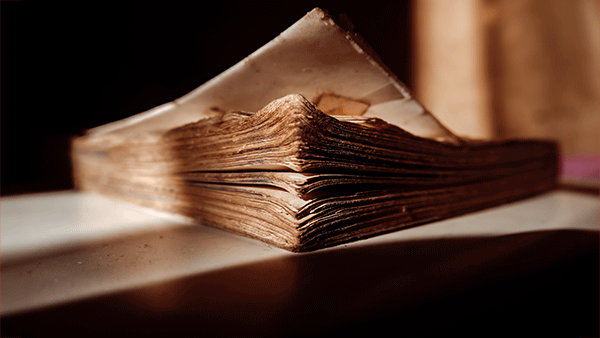Le baromètre national de la science ouverte indique qu’en France, seulement 44 % des essais cliniques finalisés donnent lieu à une publication ou à un dépôt de résultats dans un registre public. Pour les promoteurs académiques, ce chiffre descend à 37 %.
Résultats neutres : utiles, attendus, obligatoires
Diffuser ses résultats n’est pourtant pas une option. Depuis 2022, les résultats d’un essai clinique doivent être déposés dans un registre public dans les 12 mois suivant la fin de l’essai, indépendamment de leur publication dans des revues scientifiques évaluées par les pairs.
C’est aussi une obligation éthique — vis-à-vis des participants qui ont donné de leur temps, parfois pris des risques, dans l’espoir de faire avancer la science.
Comme le rappelle une étude du CHU de Rennes parue en avril 2024, environ 70 % des essais cliniques menés sur place n’avaient pas été publiés. Cela représente plus de 6 700 participants et plus de 5 millions d’euros de financements, sans bénéfice collectif.
Les résultats non probants apportent pourtant une contribution majeure : ils évitent que d’autres équipes reproduisent des protocoles inefficaces, voire dangereux. En 2017, l’association Transparimed rappelait notamment l’affaire du Lorcaïnide, médicament dont les effets mortels auraient pu être évités si des données négatives avaient été publiées plus tôt.
Les résultats neutres participent aussi à la qualité des synthèses scientifiques. Comme l’explique Karolin Krause, post-doctorante au Centre de recherche en épidémiologie et statistiques : « En intégrant des résultats dits « nuls » dans des méta-analyses, il est possible de faire apparaître des tendances qu’un seul essai ne permettrait pas de détecter, ou encore d’identifier un effet dans un sous-groupe de patients. »
À l’inverse, l’omission de ces données fausse les évaluations et peut entraîner des décisions erronées. L’achat massif du Tamiflu lors de la pandémie de grippe H1N1 en est un exemple. En 2009, les États-Unis et la France ont investi massivement dans ce traitement. On a cependant découvert plus tard que certaines données initialement non publiées montraient que le traitement était bien moins efficace qu’annoncé. Une non-publication extrêmement coûteuse pour le contribuable.
Les atouts d’une diffusion large
Au-delà du dépôt des résultats dans les registres publics, plusieurs plateformes publient des études négatives, de confirmation ou des notes courtes. Parmi elles : Peer Community Journal, In&Sight ou FC3R Short Notes. Les preprints (bioRxiv, medRxiv), les archives ouvertes nationales comme HAL, ainsi que les dépôts thématiques (arXiv) offrent également des canaux de diffusion libres et rapides pour tous types de résultats. Ces solutions assurent à la fois visibilité et pérennité des données.
Pour les chercheurs, publier ses résultats ouvre plusieurs opportunités sur le plan scientifique et professionnel :
- Crédibilité scientifique renforcée : partager des résultats négatifs ou neutres, c’est faire preuve de rigueur, d’intégrité et de transparence. C’est un marqueur fort de sérieux aux yeux des pairs, des éditeurs et des financeurs. Les publications peuvent être citées, intégrées à des revues ou des synthèses
- Visibilité et réputation numérique accrues : chaque diffusion de résultats renforce la présence du scientifique dans les bases de données (PubMed, Scopus, HAL…) et renforce son profil sur Google Scholar, ORCID ou ResearchGate. Elles peuvent aussi susciter des collaborations, même si les résultats ne montrent pas d’effet significatif.
Biais des revues scientifiques
La politique éditoriale des revues, encore largement orientée vers les résultats « positifs » — c’est-à-dire conformes aux hypothèses ou statistiquement significatifs — influence directement la diffusion des connaissances. Une étude menée en 2022 sur les principales revues de radiologie clinique de rang Q1 l’illustre clairement : sur un échantillon aléatoire de 149 recherches en radiomique, une seule rapportait un résultat négatif, révélant une sous-représentation extrême de ce type de données.
Les chercheurs, souvent en quête de reconnaissance académique ou contraints par des indicateurs de performance, finissent par autocensurer des travaux pourtant solides, mais jugés moins « novateurs » ou moins publiables. Une dynamique d’autant plus problématique qu’elle pèse sur la qualité et l’exhaustivité des connaissances scientifiques.
En savoir plus :