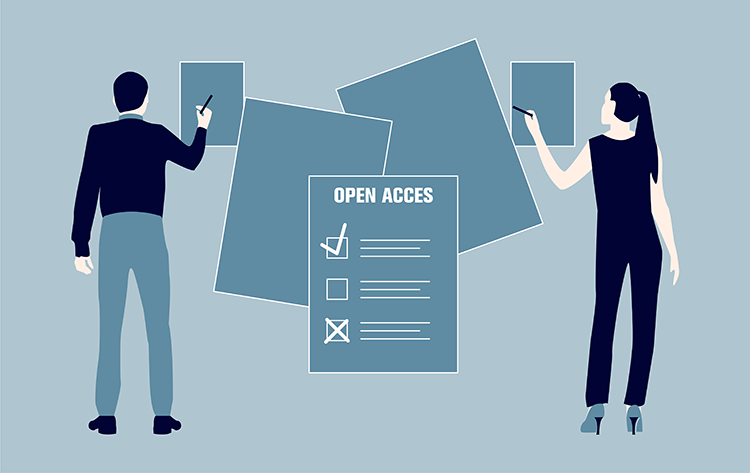L’essor de la science ouverte, soutenue au niveau national et européen, bouleverse le paysage de l’édition scientifique. Dans un contexte où un accès rapide et ouvert aux résultats de recherche apparaît comme une priorité, l’émergence des revues Open Access, des archives ouvertes et des plateformes de diffusion d’articles preprint a ravivé un débat animé sur les modes d’évaluation de la littérature scientifique. Aujourd’hui, ces modèles de diffusion alternatifs suscitent tour à tour enthousiasme, craintes et réticences. Les chercheurs appellent de leurs vœux des directives collectives qui permettraient de lutter contre les abus des éditeurs et de favoriser l’accès à la science pour tous, mais dans le même temps, ils ne se représentent pas toujours très bien les pratiques de leurs pairs – en particulier dans des équipes et disciplines différentes des leurs. Les résultats de l’enquête de l’IST donnent un bon aperçu des modes de participation actuels à la science ouverte dans le milieu biomédical.
Sans surprise, l’immense majorité des répondants (83%) estime que le modèle classique des abonnements n’est plus viable. Ils sont bien informés des difficultés que rencontrent les structures de recherche dans les négociations avec les éditeurs et des conséquences possibles de ce bras de fer. Cependant, si 73% d’entre eux ont déjà publié dans des revues Open Access (OA), les trouvant parfois de grande qualité, ils émettent quelques réserves sur la systématisation de cette pratique.
Pour des raisons budgétaires d’une part, mais surtout, par crainte qu’une vision négative de ces revues, parfois assimilées au phénomène des revues prédatrices, ait des conséquences néfastes sur leur évaluation.
L’enquête révèle qu’il subsiste une méconnaissance des archives de type HAL et des droits associés au dépôt d’articles publiés. Quant à l’utilisation des plateformes de prépublication, elle reste encore limitée : les chercheurs restent attachés au
peer review et sont demandeurs de marqueurs de qualité scientifique pour s’orienter dans la littérature, même si le facteur d’impact (IF) constitue à leurs yeux un indicateur insuffisant.
Pour un plus large accès à la science
Aujourd’hui, le modèle traditionnel de l’édition scientifique est considéré comme inadapté aux besoins actuels de la recherche publique, dont les résultats doivent être mis à disposition rapidement et au plus grand nombre afin de favoriser la collaboration, la réactivité et l’innovation. Les répondants lui reprochent avant tout de « restreindre l’accès à la science pour tous », dans la mesure où les publications sont protégées par des paywalls, et que la cession des droits patrimoniaux aux éditeurs constitue une entrave à la réutilisation des résultats de recherche. Par ailleurs, les éditeurs augmentent continuellement le prix des abonnements, qui constituent un coût démesuré pour les institutions. Ce coût est perçu comme injuste, « tout le travail étant réalisé par les chercheurs et financé en grande partie par l’État », selon un répondant. Il est également perçu comme abusif en regard du service rendu, dans la mesure où les éditeurs se trouvent dans une situation de quasi oligopole : « Le fait que l’édition scientifique soit l’une des entreprises les plus rentables au monde pointe un souci de modèle économique », explique un chercheur. Enfin, le système de
peer review des grandes revues n’apparaît pas comme un gage absolu de qualité.
La valorisation des carrières par un système aussi bancal et opaque est problématique.
Est-il pour autant possible de protester efficacement contre ce système ? 76% des répondants pourraient envisager de refuser le travail de peer review si, suite à l’échec des négociations avec un éditeur majeur, l’accès à des revues de première importance menaçait d’être coupé. Si certains optent pour l’intransigeance, « Tout ce qui peut bloquer les éditeurs qui tentent de faire perdurer un modèle pour leur seul profit me convient », d’autres estiment que seul un mouvement général serait efficace, et qu’il doit être coordonné et assumé par la hiérarchie : « Je serais favorable à ce que l’institution demande ce boycott à tous ses chercheurs. »
Malheureusement, la dépendance historique aux groupes propriétaires des revues les plus prestigieuses, comme Science ou Nature, qui ont structuré le paysage de recherche et le système d’attribution de valeur et de prestige scientifique, semble difficile à surmonter. « Dans l’état actuel de la compétition pour les financements et la visibilité internationale, il est impensable de ne pas chercher à publier dans les meilleures revues, quelles qu’en soient les conditions », avoue un répondant. Cet argument est particulièrement valable pour les chercheurs en début de carrière. Ainsi, un autre chercheur estime qu’il faut éviter d’appeler au boycott, par solidarité avec les membres de son équipe : « S’il en va de la carrière de mes collaborateurs, je ne vois pas d’options. »
L’open access en forte progression
Si 73 % des répondants ont déjà publié au moins une fois dans une revue OA en s’acquittant des frais associés (Article Processing Charges, ou APC), c’est pour augmenter la visibilité de leurs travaux, et les rendre immédiatement accessibles à leurs pairs ainsi qu’à l’ensemble de la société. Certains sont également soumis à une obligation de publication en OA, une condition liée à l’obtention de financement de plus en plus fréquente.
Mais si la perspective de donner un accès universel à la recherche est très motivante, elle s’accompagne de son lot de contraintes : 29 % des chercheurs qui ont déjà publié en OA sont régulièrement freinés par des problèmes de budget, et 49%, ponctuellement. La qualité de ces revues et leur prise en compte dans l’évaluation soulève également quelques réserves ; c’est d’ailleurs la principale crainte des répondants n’ayant jamais publié en OA. Enfin, certains chercheurs, même favorables au principe de l’OA, sont inquiets à l’idée que ce mouvement puisse accélérer la vitesse de la publication scientifique, « source d’erreurs potentielles et de bruit de fond susceptible de ralentir le progrès » – formulant ainsi une idée analogue aux principes du mouvement
slow science.
L’Inserm devrait prendre en charge toute ou partie des frais de publication dans les journaux Open Access pour stimuler la transition. Le système Open Access est le meilleur outil pour que les organismes soient en position favorable lors des négociations des abonnements avec les éditeurs des revues conventionnelles.
Ouvrir les données biomédicales quand c’est possible
Toujours dans une perspective de progression vers une science ouverte, 85% des répondants sont favorables à l’idée de rendre accessibles les données sous-jacentes à une publication. « Au regard de l’intégrité scientifique, ça paraît indispensable et ça devrait être la règle. La réutilisation de données devrait être valorisée dans l’évaluation, tant pour celui qui met à disposition que pour celui qui utilise des données existantes plutôt que d’en refaire », explique un répondant.
Pourtant, de nombreuses difficultés sont évoquées, en premier lieu d’ordre éthique et clinique : « Le problème se pose pour les données de séquençage car il arrive que je n’ai pas le consentement des patients pour faire cela » précise un chercheur. Cette contrainte éthique, caractéristique des disciplines biomédicales, explique peut-être en partie leur adhésion lente et prudente aux pratiques OA – à l’inverse des sciences physiques qui ont moins l’occasion de manipuler des données personnelles, confidentielles ou ayant un impact potentiel pour la vie privée.
Citons également le problème de l’équité des données partagées : un répondant explique par exemple qu’il travaille sur des données de santé de populations vivant dans des pays à faible/moyen revenus et que celles-ci sont exploitées principalement par des chercheurs ou entités basés dans des pays riches, ce qui lui pose problème. Enfin, les données non homogènes, non éligibles à un formatage normatif, non propriétaires ou trop volumineuses restent difficilement exploitables, notamment sur le temps long.
La science avant le peer review
En amont du système de peer review des revues classiques et des revues OA, un système de dépôt des travaux en cours s’est développé afin de favoriser les commentaires des pairs et de permettre aux chercheurs de gagner en visibilité : les plateformes de prépublication. Or, leur utilisation divise pour des raisons parfois contradictoires. Ainsi, la lutte contre le plagiat est invoquée par les chercheurs favorables au modèle preprint, puisqu’il permet de dater l’hypothèse, le modèle, le design expérimental, les résultats considérés de manière précise – en cas de conflit ultérieur sur la paternité d’une découverte, par exemple. Les chercheurs défavorables évoquent eux aussi la lutte contre le plagiat, pour une toute autre raison : ils craignent que les idées et données présentées en preprint ne soient repris par une équipe concurrente en mesure de publier rapidement dans un journal prestigieux. « Si tous les auteurs suivaient les règles d’éthique, je dirais oui, mais c’est loin d’être le cas. L’intégrité n’est généralement pas payante côté citations et carrière ».
Enfin, le système de prépublication suscite une autre inquiétude : l’augmentation du « bruit » compliquant la démarche scientifique. « Après expertise, plus de 60% des résultats sont non-reproductibles ; si on pollue la littérature avec des résultats et interprétations bruts et non expertisés par les pairs, cela peut devenir une plus grande pagaille », explique un répondant. En outre, cette « pagaille » pourrait être amplifiée par la diffusion de résultats repris de manière non critique par des médias ou des chercheurs non experts du domaine considéré.
Une progression de l’adhésion au modèle preprint est à attendre toutefois, dans la mesure où les chercheurs ayant déjà déposé dans bioRxiv, la principale plateforme citée, conviennent qu’ils ont testé le système après incitation de leurs pairs – quand 40% de ceux qui n’ont jamais déposé précisent que leur réserve est due à un manque d’information. Une affluence de nouveaux chercheurs disposés à publier des preprints respectant les standards de qualité pourrait donc entraîner un engouement pour la prépublication. Reste à savoir si les chercheurs pourront rénover le principe du peer review, décrit comme le pilier sur lequel s’appuie toute la tradition scientifique. L’alternative étant de diffuser d’abord, publier ensuite – voire ne pas publier du tout.
Il est préférable d’avoir la fierté d’un travail propre et bien mené par soi-même, que son nom en premier ou deuxième dans une revue prestigieuse sans avoir participé au travail.
Les archives ouvertes, encore largement méconnues
38 % des chercheurs interrogés déposent souvent dans HAL et 15%, parfois. Pour beaucoup, il existe une méconnaissance des archives ouvertes et de leur fonctionnement. La moitié des répondants jugent que le dépôt sur la plateforme est laborieux et ne présente pas de bons résultats d’importation/exportation. Ils l’utilisent donc avec parcimonie, essentiellement pour répondre aux messages d’incitation des tutelles et participer à leur échelle au mouvement de l’OA.
Cette retenue s’explique également par une incertitude sur les documents éligibles à un dépôt : « Que cela devienne un journal scientifique et que les articles dans HAL soient reviewés », suggère un chercheur. C’est sans doute cette ambiguïté qui pousse certains répondants à partager leurs travaux sur des plateformes plus informelles mais favorisant davantage l’exposition professionnelle – comme les réseaux sociaux, blogs, ou LinkedIn. Notons également que 58% des répondants ne savent pas que l’attribution de certains financements majeurs, comme ceux de la Commission Européenne, entraîne une obligation de dépôt en archive ouverte de toutes les publications issues de ces financements.
Seuls les chercheurs publiant dans des journaux à fort IF sont considérés comme méritants, travailleurs, intelligents et intègres. Or, c’est un leurre, car plus le domaine est compétitif et difficile d’accès, plus il induit de conflits d’intérêts et de tricherie.
L’impact factor (IF), un indicateur dévoyé ?
Si l’impact factor est considéré comme un indicateur utile mais insuffisant pour apprécier la qualité d’une publication au sein d’une revue scientifique, la multiplication des journaux OA relance le débat sur la bonne manière de le prendre en compte. En effet, si plusieurs revues OA de référence ont acquis un IF élevé, de nombreuses autres, très récentes, n’ont pas encore reçu leur premier IF. Un grand nombre de chercheurs estiment encore que l’OA est synonyme d’un IF insuffisant, ce qui conditionne leur stratégie de publication. « Les journaux en open access ont un faible impact factor. Ils sont très peu valorisés par l’HCERES et par les CSS et CS Inserm. Publier nos gros papiers là-dedans est suicidaire », explique un répondant.
Ainsi, dans leur choix d’une revue dans laquelle publier, 83% des chercheurs se fient avant tout à sa renommée au sein de leur spécialité. Malheureusement, ce prestige n’est pas toujours facile à évaluer ; en l’absence d’indicateurs quantitatifs il faudra parfois faire appel à des indices subjectifs liés au réseau scientifique et à l’expérience professionnelle : « L’élément majeur est le lectorat que je perçois des différents journaux », précise un chercheur.
Bon gré, mal gré, l’IF reste un indicateur très consulté ; il est considéré comme un marqueur de notoriété et de visibilité utile à l’avancement des carrières, et notamment à l’obtention de financements. 78% des répondants jugent le rôle du facteur d’impact dans l’évaluation de leurs travaux important, voire trop important. « Mon choix est nécessairement guidé par l’IF même si c’est contre mon opinion ; mais c’est sur ce critère que je suis évaluée comme chercheuse, que la qualité de mon équipe est évaluée » ; « Même si la qualité et l’excellence ne sont pas au rendez-vous, je préfère publier dans les journaux “commerciaux” à fort IF car, d’expérience, ils font la différence sur un CV », expliquent des chercheurs.
Enfin, l’IF est toujours utilisé comme un outil de tri devant l’abondance de la littérature – sans se substituer pour autant à une analyse méticuleuse et critique de l’article considéré. Certains répondants appellent à une méfiance toute particulière devant les revues à fort IF, perçues comme favorisant les auteurs les plus renommés et sélectionnant en priorité les sujets innovants : « C’est souvent des sujets à la mode, avec les dernières techniques très chères et à la pointe, ce n’est pas pour autant que les articles sont excellents. »
Dans cette longue transition vers une science plus ouverte qui permettrait de nouveaux modes de participation, les indicateurs de l’édition scientifique classique demeurent des outils familiers dont il est difficile de se séparer, quoique leur légitimité soit fortement ébranlée. Devant cette contradiction, certains chercheurs appellent déjà à la révolution.
Le système actuel d’exploitation par les éditeurs est aberrant mais c’est tout le système obsolète de la publication scientifique qui doit être remis en question. De nouveaux outils de communication doivent être développés, et l’Inserm pourrait être leader en ce domaine.