Qu’avez-vous ressenti lorsque vous avez appris que vous étiez lauréat du Grand prix Inserm ?
Éric Gilson : Je ne m’y attendais pas du tout. Ça a été une grande surprise et une grande émotion. Je me suis surtout demandé pourquoi moi ? Mes recherches ont longtemps porté sur la structure des chromosomes avant de s’orienter vers des questions plus médicales. Cette récompense met en lumière l’importance du lien entre la recherche d’amont et son application. C’est une grande satisfaction et un encouragement à continuer.
Arnold Munnich : Je m’en souviens très bien. J’étais extrêmement surpris et totalement bouleversé. Ma première impression a été de ne pas m’en sentir digne. Je pensais pour ce prix à de grands chercheurs fondamentalistes, alors que toute ma vie était consacrée à la recherche translationnelle : comment transformer la science en bénéfices pour les patients ? Longtemps, il a été implicite pour beaucoup qu’une recherche appliquée perdait de son caractère scientifique. Peut-être le Grand prix de l’Inserm allait-il constituer un encouragement adressé aux chercheurs à ne pas tourner le dos aux patients et aux médecins à aller le plus loin possible dans la formation à la recherche et par la recherche.
Qu’est-ce que l’Inserm vous a apporté dans votre carrière ?
Éric Gilson : J’ai commencé comme chercheur au CNRS. D’abord à l’Institut Pasteur, puis au Laboratoire de biologie moléculaire de la cellule (LBMC) à l’École normale supérieure de Lyon. Déjà, dans les années 2000, j’avais demandé sans succès le rattachement de cette unité CNRS à l’Inserm pour favoriser les échanges avec la recherche médicale. Puis en 2012, j’ai créé l’Institut de recherche sur le cancer et le vieillissement (Ircan) à Nice – avec l’Inserm, l’université de Nice Sophia-Antipolis et le CNRS comme tutelles. La contribution de l’Inserm a été déterminante. Sans elle, il n’aurait par exemple pas été possible de recruter Dmitry Bulavin, spécialiste mondial de la réponse au stress qui était à Singapour. Travailler en pleine confiance à la fois avec le CNRS et l’Inserm facilite le continuum de la recherche fondamentale vers le transfert médical. Si les tutelles multiples posent des problèmes de gestion au quotidien, elles favorisent aussi les échanges et les complémentarités.
Arnold Munnich : En rejoignant le laboratoire Inserm de Jacques Hanoune à Henri Mondor en 1976, j’ai appris à raisonner avec rigueur. C’était un endroit où on pouvait rêver, imaginer, inventer et rencontrer des gens différents. L’Inserm et ses laboratoires m’ont forgé l’esprit et ont fait de moi ce que je suis.
À 20 ans, comment envisagiez-vous votre avenir ?
Éric Gilson : Comme il est maintenant. Depuis tout petit, je suis curieux et veux comprendre comment la nature fonctionne. Très jeune je dévorais les livres de Jean Rostand et de Konrad Lorenz. Lorsqu’en première, ma professeure de sciences naturelles nous a expliqué les liens entre la biologie et la chimie, j’ai su que je voulais être chercheur en biologie. J’ai fait médecine avec l’idée que cela pouvait être un tremplin vers la recherche et que si je ne parvenais pas à être chercheur, être médecin serait de toute façon passionnant. Puis après la deuxième année d’étude médicale, j’ai intégré l’École normale supérieure. Entrer à l’ENS comme élève médecin à vingt ans, ça donne incroyablement confiance en soi et une envie décuplée de réaliser de grands projets. J’ai eu beaucoup de chance.
Arnold Munnich : J’avais 18 ans en mai 1968. J’étais peu impliqué dans mes études de médecine au point d’hésiter à préparer l’internat. Je pensais que le monde allait changer et qu’il n’était plus question de se projeter dans une carrière quelle qu’elle soit. Puis je me suis finalement ressaisi. J’avais été démobilisé par mimétisme, je me suis également remis à travailler par mimétisme. Reçu à l’internat, j’ai ressenti le besoin de me doter d’une formation supplémentaire pour contribuer, si je le pouvais, à l’innovation en médecine. Je me suis inscrit en fac de sciences, puis je suis allé à Henri Mondor pour préparer mon Diplôme d’études approfondies (DEA) en endocrinologie moléculaire. Mondor appartenait à ces CHU nouvellement créés autour de Paris où se retrouvaient de jeunes talents de mai 1968 devenus professeurs.

Comment en êtes-vous venu à concentrer vos recherches sur un âge de la vie en particulier ?
Éric Gilson : Je ne me pas suis intéressé au vieillissement tout de suite. J’ai d’abord essayé de comprendre la raison d’être des séquences d’ADN répétées qui constituent la moitié du génome humain et dont on a longtemps pensé qu’elles ne servaient à rien. Dans les années 1990, je me suis intéressé aux télomères, ces séquences d’ADN répétitives qui protègent et stabilisent les extrémités des chromosomes. Les étudier répondait à mon interrogation de départ en démontrant l’utilité de séquences répétées.
De proche en proche, je me suis intéressé aux relations entre les changements télomériques et les mécanismes responsables de la perte des fonctions de nos cellules et de nos organes au cours du vieillissement. Je porte un intérêt particulier aux maladies associées au vieillissement : cancers, maladies neurodégénératives, cardiovasculaires, arthrose… la liste est malheureusement longue. Je reviens ainsi à des préoccupations médicales après une longue période de recherche fondamentale, ce qui à titre personnel est très satisfaisant.
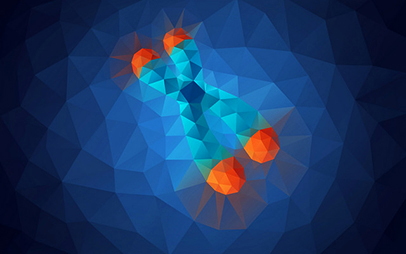
Arnold Munnich : J’avais envie d’être pédiatre. Au cours de mes études de médecine, c’est dans les services de pédiatrie que j’ai trouvé le plus d’humanité. L’enfance est la période la plus vulnérable et les pédiatres sont d’une douceur presque maternelle avec les enfants. Faire de la recherche en pédiatrie impliquait d’opter pour l’immunologie ou pour la génétique. J’ai choisi la génétique. Il n’y a pas pire injustice que les injustices de la naissance.
Aujourd’hui je suis très concentré sur les questions liées au neuro-développement à travers l’Institut des maladies génétiques Imagine à Paris. Je m’intéresse plus particulièrement au déchiffrage des bases génétiques et moléculaires des syndromes autistiques et à la diffusion des savoirs pour lutter contre les inégalités d’accès aux diagnostics et aux soins. Je tente aussi d’avancer dans des essais cliniques sur les maladies neuro-développementales.
Qu’est-ce qui selon vous a le plus changé dans le travail de chercheur depuis 20 ans ?
Éric Gilson : Quand j’ai commencé, il était plus facile pour les laboratoires de soutenir des recherches émergentes qui ne répondaient pas directement aux critères académiques du moment. Grâce à mon statut de chercheur fonctionnaire, j’ai pu entreprendre des expériences à risque sans forcément avoir de résultats rapidement. C’est plus difficile maintenant. Le fossé entre le statut personnel des chercheurs titulaires et les moyens pour mener leurs recherches est un problème majeur du système français actuel. Je pense que le statut de chercheur à vie est une chance pour favoriser des recherches innovantes et doit être préservé. Mais il doit s’accompagner de moyens récurrents adéquats et de passerelles entre les activités de recherche et d’enseignement.
Arnold Munnich : Les technologies ont connu un véritable essor, en particulier avec la création de plateformes mutualisées. Elles supposent une recherche pluridisciplinaire et collective, regroupant des compétences très diverses : imagerie, animalerie, informatique, microscopie confocale, etc. La recherche nécessite aujourd’hui de gros moyens technologiques, financiers et humains, synonymes de mutualisation.
Et comment voyez-vous le métier de chercheur dans 20 ans ?
Éric Gilson : Je souhaite que la liberté d’investigation soit préservée et que la curiosité intellectuelle soit encouragée. Il faut conserver « la biodiversité des chercheurs ». Lors de leur recrutement et de leur financement, il faut également promouvoir des recherches en rupture par rapport aux concepts dominants. Ce n’est pas tâche facile mais c’est, je crois, essentiel.
Arnold Munnich : J’ai la hantise que la science devienne inhumaine. Le développement de la génétique fait peser des risques énormes sur la société. En croisant les bases de données selon des indicateurs de performance avec les données de la génomique, il sera peut-être difficile de résister à la tentation d’un néo-eugénisme pseudo-scientifique. C’est une vision pessimiste, mais la prophétie du malheur sert précisément à éviter qu’elle se produise. La perversion de la recherche par l’argent m’inquiète également. La dimension de partage doit être au cœur des avancées de la recherche. Marina Cavazzana – Prix de recherche Inserm 2006 – fournit un magnifique exemple de ce souci constant. Elle a voulu rendre accessible à tous la thérapie génique de la drépanocytose, une maladie qui décime l’Afrique. Le vrai progrès, c’est le partage du progrès.

Si vous aviez été chercheur à une autre époque, à quel moment de l’histoire des sciences auriez-vous aimé participer ?
Éric Gilson : J’adore l’époque que j’ai traversée et la période actuelle. J’ai eu la chance de vivre une transition passionnante entre une approche réductionniste des organismes et une étude de la diversité du vivant. En biologie moléculaire, les mécanismes fondamentaux étaient appréhendés à travers quelques organismes modèles étudiés au laboratoire. Aujourd’hui, tous les êtres vivants, même et surtout dans leur environnement naturel, peuvent nous livrer des processus biologiques inédits.
Cette évolution a été rendue possible par le développement des « omiques ». Ce suffixe correspond aux technologies qui permettent de déterminer les réactions et les constituants de tous les organismes vivants. La biologie moderne tend ainsi vers une description intégrée des fonctions globales de tous les organismes vivants, et donc aussi des patients. C’est dans cette perspective que j’ai créé l’Ircan. Pour trouver des stratégies d’interventions personnalisées qui permettent de prévenir ou d’intercepter simultanément de multiples maladies liées au vieillissement.
Arnold Munnich : J’aurais voulu être à demain et faire de l’imagerie. C’est une méthode d’accès non invasif à la connaissance, qui va également devenir un outil thérapeutique majeur. La radiologie pourrait bien remplacer l’endoscopie et certains actes de chirurgie.


